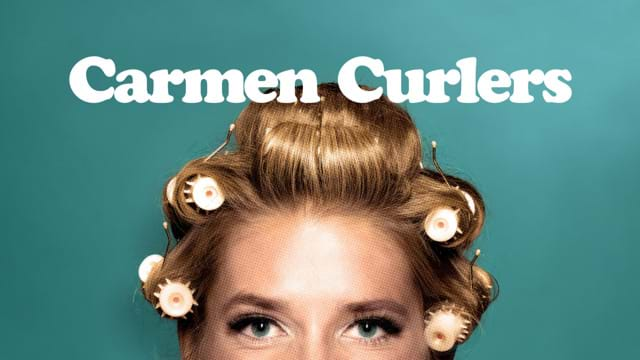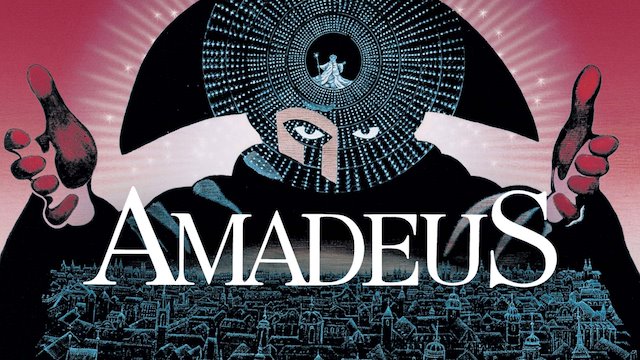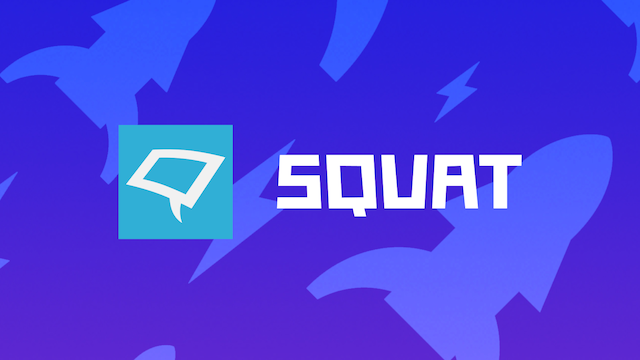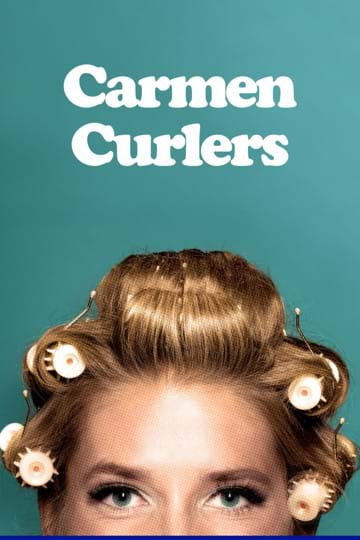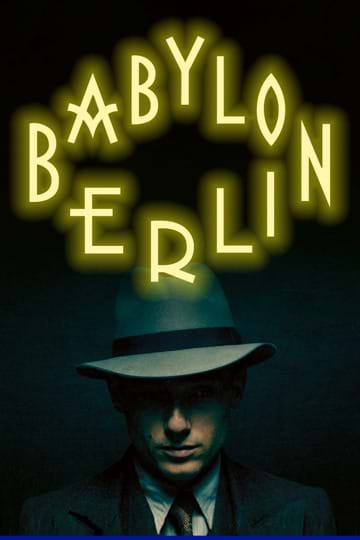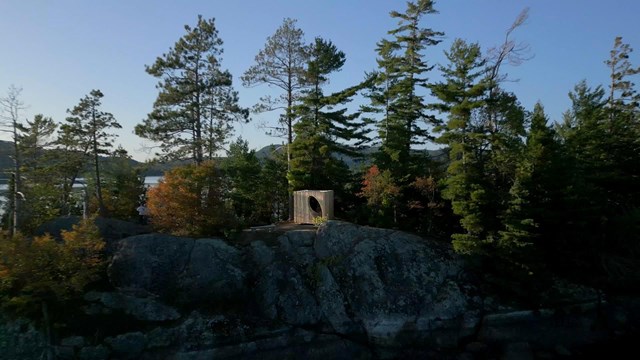En vedette
Samedi à 19h, en primeur en ligne
SÉRIE | Une série de fiction danoise
Carmen Curlers
En ligne
SÉRIE | 9 saisons à dévorer!
Les Enquêtes de Morse
Samedi à 21h
CINÉMA | Récompensé à la Cérémonie des Oscars
Amadeus
Du lundi au jeudi à 18h, à la télé et en ligne
SÉRIE JEUNESSE | L'émission préférée des petits
Passe-Partout
Tendances actuelles
Restez en contact avec nous
Abonnez-vous à l'infolettre