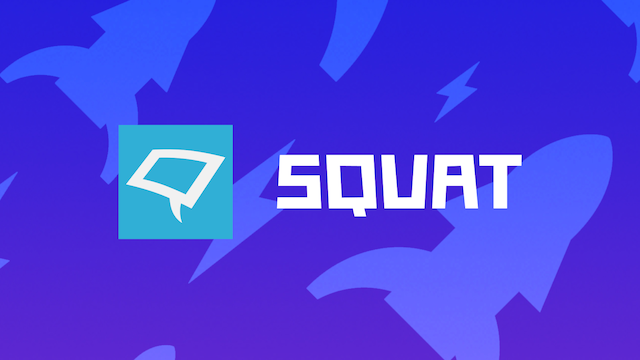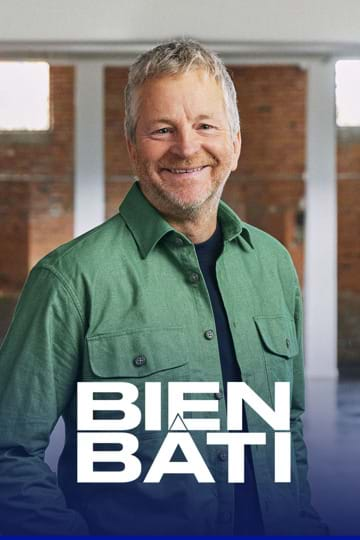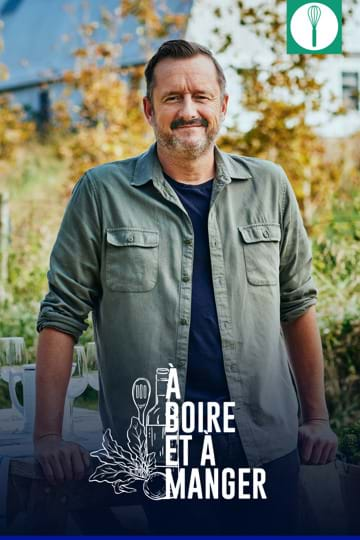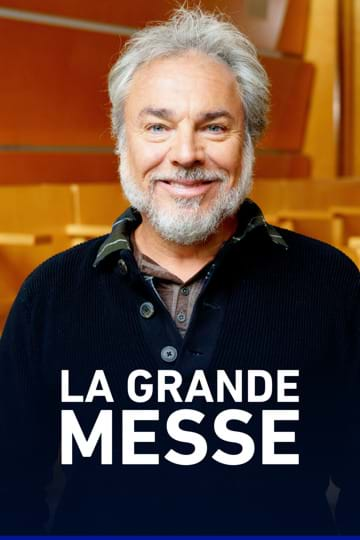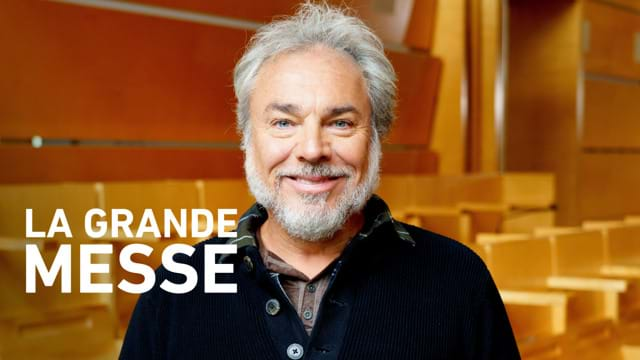En vedette
En ligne
SÉRIE JEUNESSE | Aïna, Arnaud, Théo et leurs secrets
Le pacte
Dimanche à 21h30, en primeur en ligne
CINÉMA | Récompensé à la cérémonie des César
La nuit du 12
En ligne
EXCLUSIVITÉ | La philosophie de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques
Philo pop
Samedi à 21h, en ligne le soir même
CINÉMA | En Afghanistan, le 3 octobre 2009
Assiégés
Tendances actuelles
Restez en contact avec nous
Abonnez-vous à l'infolettre